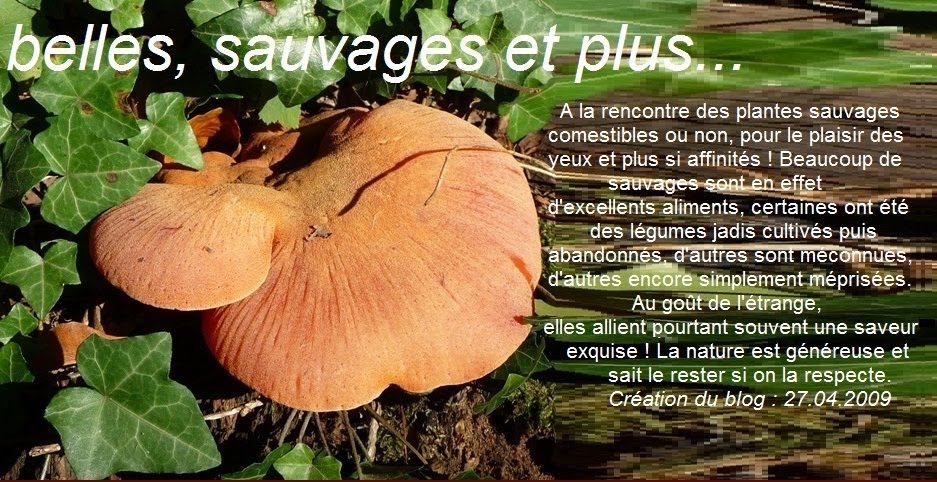Dans mon précédent billet, je parlais du désherbage de printemps, ce grand nettoyage de mes jardins bretons après une longue période d'absence. J'ai mis au moins deux jours avant de me décider à faire place nette. Jusqu'à présent, j'essayais de faire cohabiter "sauvages" spontanées et plantes "cultivées" mises en place après bien des efforts de bêchage (il y a des cailloux partout !) et de ratissage pour ameublir la terre, souvent très lourde quand elle n'est pas de bruyère. Après une semaine d'effort intensif, j'ai redonné un peu de relief aux arbustes en fleurs, qui ont enfin pris leur envol pour des floraisons dignes de ce nom. On dit qu'il faut au moins trois ans avant qu'un jardin ne devienne "adulte", je veux bien le croire. Ici, il a mis plus de cinq ans avant de donner quelque chose de présentable, sauf que l'année dernière une erreur de mon jardinier a fait disparaître tout un massif de rugosas et d'escallonias enfin adulte ! Du coup, j'ai dû replanter un quart du jardin, partie qui n'en est donc à nouveau qu'à son premier balbutiement. Mais c'est la première année que je profite de mon rhododendron. Il manquait de lumière, même si c'est une plante d'ombre, il en faut quand même un minimum pour favoriser sa végétation. Or il était complètement occulté par un genêt cytise, que j'ai coupé à l'automne dernier, ce qui lui a permis de s'épancher lentement mais sûrement. Un camélia que j'ai installé à l'état de jeune plant a aussi pris un peu de hauteur et fleurit bien.
 J'avais acheté ce rhodo dans le Jura pour l'offrir. Il était alors... violet ! Il est resté chez la donataire en pot plus d'une année, mais comme elle ne savait pas où le mettre dans son jardin, à sol tendance très calcaire et sec, elle a préféré me le redonner (!) pour mon jardin breton. Grand bien lui a fait, la terre acide, de bruyère qui plus est, étant idéale pour lui, même si je l'ai planté dans un endroit improvisé car, à l'époque, cette partie du jardin était la seule aménagée, mais j'y avais déjà planté des arbustes à croissance rapide (genêt, anthémis, weigelia) qui lui ont très vite fait de l'ombre. Certes, les rhododendrons (arbuste ou arbre - j'en ai vu dans la nature d"une taille impressionnante de plus de dix mètres - de la famille des Ericacées) supportent bien l'ombre, mais un peu de lumière est quand même nécessaire pour une bonne croissance. Après plusieurs années de végétation cahotique, j'ai décidé de lui donner une autre chance, et, à l'automne dernier, j'ai dégagé un genêt-cytise pour lui laisser un peu plus d'espace et de lumière, il a apprécié, c'est la première année que je profite de ses fleurs en abondance !
J'avais acheté ce rhodo dans le Jura pour l'offrir. Il était alors... violet ! Il est resté chez la donataire en pot plus d'une année, mais comme elle ne savait pas où le mettre dans son jardin, à sol tendance très calcaire et sec, elle a préféré me le redonner (!) pour mon jardin breton. Grand bien lui a fait, la terre acide, de bruyère qui plus est, étant idéale pour lui, même si je l'ai planté dans un endroit improvisé car, à l'époque, cette partie du jardin était la seule aménagée, mais j'y avais déjà planté des arbustes à croissance rapide (genêt, anthémis, weigelia) qui lui ont très vite fait de l'ombre. Certes, les rhododendrons (arbuste ou arbre - j'en ai vu dans la nature d"une taille impressionnante de plus de dix mètres - de la famille des Ericacées) supportent bien l'ombre, mais un peu de lumière est quand même nécessaire pour une bonne croissance. Après plusieurs années de végétation cahotique, j'ai décidé de lui donner une autre chance, et, à l'automne dernier, j'ai dégagé un genêt-cytise pour lui laisser un peu plus d'espace et de lumière, il a apprécié, c'est la première année que je profite de ses fleurs en abondance ! 

S'agissant des camélias (ou camellia), de la famille des Theaceae, dont le fameux Camellia sinensis, le théier, le nombre d'espèces que contient le genre varierait entre, rien moins que 100 à 250 espèces selon les botanistes ! Ce sont des arbres à croissance de tortue, alors je ne m'inquiète pas. Celui de ce jardin planté par moi n'a pas encore huit ans. Il commence à pousser en hauteur et fleurit bien. Les camélias rouges sont mes préférés.


 Ci-contre, c'est un camélia, rouge aussi, qui a plus de cinquante ans. Il a été laissé à l'abandon dans ce jardin en friche depuis fort longtemps quand j'ai acheté la seconde maison. Il était très abîmé, envahi jusqu'au sommet de ronces, de fougères et de pervenches ! Une fois dégagé, il est reparti doucement, même s'il va falloir le tailler un peu. J'attends que le terrain soit défriché entièrement, le mois prochain, après les gros travaux d'assainissement prévus pour ce penty. J'espère que l'entrepreneur fera attention de ne pas le "dégager" avec toute la broussaille, j'irai quand même sur place pour surveiller, parce que... euh, ils ont tendance à faire le nettoyage par le vide ici ! A côté, pousse un beau massif d'hortensias, mais bon, je ne peux non plus leur demander de slalommer partout avec leurs gros engins ! Dans mon premier jardin, des racines d'hortensia avaient réussi à survivre à la pelleteuse et des plantes sont réapparues deux ans après, l'espoir demeure ! Ce grand camélia est en retard cette année, il est à peine en boutons. Il paraît que les intempéries, les périodes de grand froid alternant avec les périodes de chaleur hors normes en hiver, ont eu raison de beaucoup de son espèce. Certains ont complètement cramé, avec une floraison irrémédiablement perdue pour cette année, d'autres sont morts, comme l'un de mes camélias parisiens en pot, il avait vingt ans, snif !
Ci-contre, c'est un camélia, rouge aussi, qui a plus de cinquante ans. Il a été laissé à l'abandon dans ce jardin en friche depuis fort longtemps quand j'ai acheté la seconde maison. Il était très abîmé, envahi jusqu'au sommet de ronces, de fougères et de pervenches ! Une fois dégagé, il est reparti doucement, même s'il va falloir le tailler un peu. J'attends que le terrain soit défriché entièrement, le mois prochain, après les gros travaux d'assainissement prévus pour ce penty. J'espère que l'entrepreneur fera attention de ne pas le "dégager" avec toute la broussaille, j'irai quand même sur place pour surveiller, parce que... euh, ils ont tendance à faire le nettoyage par le vide ici ! A côté, pousse un beau massif d'hortensias, mais bon, je ne peux non plus leur demander de slalommer partout avec leurs gros engins ! Dans mon premier jardin, des racines d'hortensia avaient réussi à survivre à la pelleteuse et des plantes sont réapparues deux ans après, l'espoir demeure ! Ce grand camélia est en retard cette année, il est à peine en boutons. Il paraît que les intempéries, les périodes de grand froid alternant avec les périodes de chaleur hors normes en hiver, ont eu raison de beaucoup de son espèce. Certains ont complètement cramé, avec une floraison irrémédiablement perdue pour cette année, d'autres sont morts, comme l'un de mes camélias parisiens en pot, il avait vingt ans, snif !
Mais je n'ai pas pour autant pu me résigner à éliminer toutes les sauvages : la lunaire bisannuelle (Lunaria annua - L.) a envahi certains coins du jardin, je la laisse fleurir, après on verra, j'aime trop ses fleurs bleues. En revanche, contrairement à beaucoup de personne, je déteste ses fleurs fanées qu'on garde sous le nom de "monnaie du pape", j'en garde seulement quelques-unes pour les graines. En règle générale, je n'aime pas les fleurs fanées ou séchées, telles que celle-ci, les chardons, les immortelles et autres...
FICHE DESCRIPTIVE : la lunaire est une plante bisannuelle, robuste, à tige rameuse. Au départ de la végétation, la première année, elle forme une rosette de feuilles grossièrement dentées, vert sombre à bleuté, très denses et pétiolées à la base. Cette rosette grossit très vite et devient volumineuse à la base. Ses fleurs sont groupées au sommet de la tige érigée, elles ont 4 pétales, comme toutes celles de la famille des Cruxifères, leur couleur varie du rose rougeâtre, au mauve, voire au bleu pour les plus courantes, mais on en trouve aussi des blanches. Ses fruits sont caractéristiques : de forme aplatie, arrondie à légèrement ovale, ils s'ouvrent en laissant apparaître une membrane argentée qui persiste longtemps après la dispersion des graines. D'où son surnom. On la trouve dans les cultures, les friches, au bord des chemins. Elle s'est naturalisée en Europe tempérée.
UTILISATION CULINAIRE : d'après certains ouvrages en ma possession, dont ceux de F. Couplan, elle est comestible, mais je ne l'ai encore jamais expérimentée en cuisine.




Quant aux autres "mauvaises herbes", quelques-unes ont fini dans mon assiette, le reste est parti dans la remorque du jardinier, je ne sais pas s'il en fait du compost, j'espère...
Après tout ce bla-bla-bla de jardinière occasionnelle, si je jouais à la cuisinière quotidienne, hein, ça creuse le grand air, bêche et râteau à la main ! J'ai quand pris le temps d'aller chercher quelques huîtres sur le rocher pour faire un ragoût. S'il fallait en manger souvent, je crois bien que je préfère les huîtres chaudes aux crues. De toute façon, vu l'état de fatigue après une bonne journée de jardinage, pas de grande cuisine très élaborée le soir pour le dîner, ou le souper, enfin, on cumule les deux vers 22h !
ragoût d'huîtres à la menthe
- 6 huîtres décoquillées par personne,
- 1 belle tranche de lard coupée en dé,
- 2 pommes de terre à purée par personne, coupés en gros morceaux,
- 1 oignon et 1 gousse d'ail hachés fin,
- quelques feuilles de menthe ciselées
- sel et poivre
- faire revenir l'oignon, l'ail et le lard dans un peu d'huile neutre,
- ajouter les pommes de terre, saler et poivrer,
- ajouter de l'eau à niveau, donner un bouillon et cuire à couvert pendant environ 20mn, à feu moyen, puis vérifier la bonne cuisson des pommes de terre,
- réduire le feu, ajouter les huîtres, mélanger doucement, juste 1 ou 2mn pour cuire un peu les huîtres, redonner un feu vif pour que le ragoût soit bien chaud,
- servir avec la menthe ciselée.

Le goût du lard se marie bien avec celui de l'huître, et j'ai beaucoup aimé la menthe dans ce plat. C'était une inspiration de dernière minute, car j'ai arraché beaucoup de cette plante très envahissante aussi dans le jardin, cela me faisait mal au coeur que tout parte à la décharge. Quand je pense que, à Paris, où j'ai plus l'occasion d'en consommer, je dois la payer cuir et poil quand j'en ai besoin !