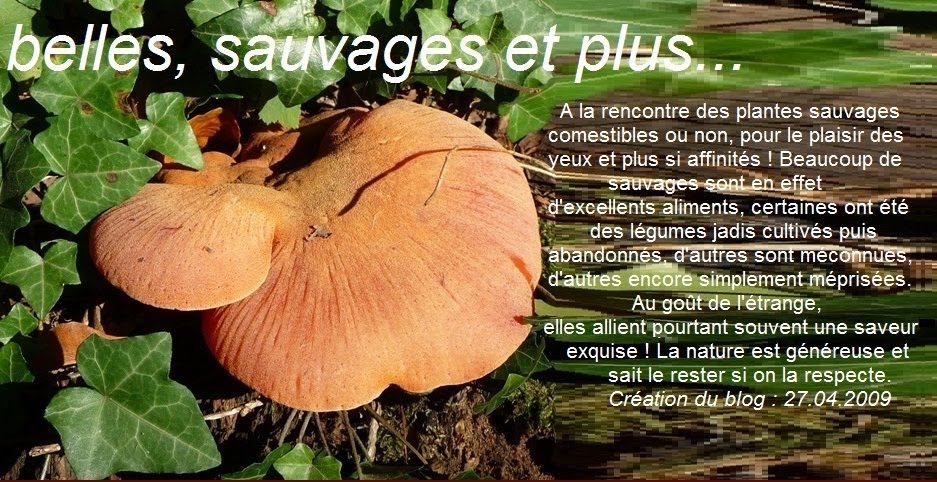Essayant de jouer à l'Arlésienne depuis un certain temps, il est enfin apparu, mais fait encore des caprices. Devinez de qui je parle ? Du printemps, bien sûr, celui qui se fait bien désirer cette année. Ses sautes d'humeur font basculer la température qui s'amuse à faire le yoyo, elles sont assez déstabilisantes pour nous, mais aussi pour les végétaux. Partie pour cueillir de la
renouée du Japon dont ce devrait être la bonne saison, je n'en ai pas trouvé beaucoup en état d'être cueillie. Juste de quoi agrémenter une soupe, un jarret de porc mijoté et un sauté de bœuf, un plat que je fais souvent avec elle, question de lui redonner un peu la mémoire de son origine asiatique. La renouée (pour sa fiche descriptive et la grande discussion à son sujet, cliquer
ICI ou
LA), ajoutée à un ragoût au dernier moment, donne un goût acidulé à la sauce que j'aime assez. Faire votre plat normalement et, cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les tiges de renouée épluchées et coupées en tronçon.
Pour le sauté de bœuf, recette déjà publiée sous ce billet-ci (
CLIC).
*********
En revanche, j'ai trouvé beaucoup de grande consoude au stade idéal pour la cuisine : de jeunes pousses bien saines, non attaquées par les insectes et sentant fortement... le poisson (plus tard dans la végétation, cette odeur s'atténue), d'où l'idée de faire ces acras de morue... sans morue ! Des acras végétariens, quoi ! Le goût y était, c'était vraiment très bon, et, ah quel bonheur, l'odeur de la morue en moins dans la maison !!!
ATTENTION : à ce stade de végétation (les deux photos ci-dessus représente la grande consoude), ne pas confondre la grande consoude, comestible, avec la digitale, très toxique.

A part l'odeur de poisson de la grande consoude, critère déterminant mais assez subjectif car selon le temps qu'il fait, le degré d'humidité, et le stade de végétation, l'odeur peut ne pas être vraiment perceptible pour un odorat moyen, il reste encore le toucher, mais là aussi, pour les mêmes raisons, tout dépend de votre sensibilité au toucher : la grande consoude, est rugueuse, son contact s'apparente vraiment à celui du velcro, tandis que la digitale est veloutée et douce sous les doigts. A un stade plus avancé de la plante, les fleurs permettent de les distinguer vraiment l'une de l'autre : la digitale fait une grande hampe d'où partent ses fleurs en forme de grosses cloches, tandis que les fleurs de la consoude sont agglomérées, au stade des boutons, en "cymes", petits bouquets de corolles tubulaires se terminant en cloche, deux fois plus longs que le calice.
Je ne saurais cependant vous conseiller d'être très prudents si vous ne connaissez pas la plante.
Pour une description plus complète, c'est spécialement ICI (et en réédition partielle à la fin de ce billet du jour) vous y trouverez beaucoup de photos à presque tous les stades de végétation de la plante, ainsi que d'autres recettes (et également dans les libellés, au mot "consoude").
feuilles de grande consoude façon acras
feuilles de consoude
oignons jaunes
ail
pour la pâte à beignets :
farine
œufs entiers, en réservant un blanc pour le monter en neige
sel et poivre
Mélanger ces ingrédients pour obtenir une pâte assez lisse, pas trop liquide.
- bien laver les feuilles de consoude (attention, les insectes s'incrustent dans ce "velcro" naturel !) une première fois à l'eau vinaigrée puis à l'eau claire
- sécher sur du papier absorbant (j'enroule dans de larges bandes de papier comme pour faire un bouquet et je secoue énergiquement en tenant le tout côté tiges, feuilles en bas)
- hacher grossièrement feuilles de consoude et oignons
- passer ce gros hachis mélangé au robot pour obtenir un hachis assez fin
- ajouter l'ail haché très fin
- mélanger à la pâte à beignets pour obtenir une pâte consistante mais pas trop ferme, au besoin ajouter un peu de farine si la pâte est trop liquide
- au dernier moment, ajouter un blanc d'œuf battu en neige ferme
- frire dans un bain d'huile très chaude en prélevant à la cuillère des portions de pâte qu'on laisse tomber dans la bassine, retourner éventuellement au bout d'une ou deux minutes (quand ça commence à dorer) et poursuivre la cuisson pour dorer l'autre face.
Servir en apéritif, ou comme entrée, ou encore comme plat végétarien avec une sauce aigre-douce qui convient bien aux beignets de... vrai poisson, et donc à ces acras sans poisson !
******
REEDITION partielle du billet contenant la fiche descriptive de la consoude
 |
| Consoude (fleurs) |
Comme tout cueilleur, il y a des périodes où je ne sais plus où donner de la tête ! (...) De la
consoude ! Aussi grandes que moi !!! Alors que certains ouvrages la donnent pour une récolte mai-juin, j’ai l’impression que c’est tout au long de l’année que je tombe nez à nez avec elle, elle m’obsède et je me demande si je n’hallucine pas quand elle se pavane avec des feuilles larges et longues jusqu’à faire 60x20 !!! Quant à celles qui me dépassent de quelques centimètres, elles sont tout simplement insolentes, et n’auront pour juste punition que de finir dans mon assiette, na !

Vous n’y croyez pas ? Ben, voici les images, et elles ne sont pas truquées, comme celles du tigre de Chine du sud !!!

Inutile de vous dire que j’aime bien cette plante sauvage (enfin, considérée comme telle puisqu’on commence à la cultiver couramment dans les jardins) qui a un goût de poisson très prononcé, ainsi que l’odeur, d’ailleurs, si bien que je la marie volontiers avec tous les produits de la mer ou des rivières. En fin de billet (...), vous trouverez quelques-unes de mes recettes préférées. De mon origine vietnamienne et de mon attirance pour une partie de la cuisine grecque, j’ai gardé la manie de tout rouler en nem ou en dolmades, donc tout ce qui s’y prête (grandes feuilles faciles à farcir) y passe !
DESCRIPTION : la consoude (Symphytum officinale L.) est une grande plante vivace pouvant atteindre plus d’1,50 m (je l’ai vérifié, elles étaient plus grandes que moi celles rencontrées hier !), plus ou moins velues, certaines ayant des soies assez raides pour pouvoir même « piquer » rudement au toucher. On peut la trouver en isolé ou en colonie, quelquefois impressionnante. Les tiges, en aile, sont dressées, rameuses dès la base. Les feuilles sont alternes, ovales se terminant souvent en pointe très effilée, quelquefois arrondies, légèrement pétiolées à la base puis soudées à la tige. On dit alors qu’elles sont « embrassantes ». Les fleurs, blanchâtres, jaunâtres, rosâtres, bleues ou lilas, sont des corolles tubulaires se terminent en cloche, deux fois plus longs que le calice, leurs boutons sont groupés en cyme scorpoïdes.
ATTENTION, risque de confusion avec la digitale TOXIQUE !
La rosace de la consoude qui apparaît au départ de la végétation peut être confondue avec celle de la digitale ! Mais au toucher, le risque est limité : la consoude est rude à cause de ses soies assez raides, parfois piquantes, son vert est plutôt tendre à foncé, tandis que la digitale est douce, d’un vert plus argentée à cause de son duvet velouté, agréable au contact. En floraison, la digitale présente une longue hampe munie de grandes corolles pourpres. C'est une plante toxique dans toutes ses parties.
 |
Feuilles de consoude farcies au thon
|
UTILISATION CULINAIRE de la consoude : tout est comestible dans cette plante. Les feuilles jeunes peuvent être ajoutées dans les salades. Personnellement, je n’aime pas trop à cause de leur contact un peu rude sur la langue, même hachées, je les utilise surtout cuites : en beignet, bien sûr, mais aussi en farcis, en nem, en dolmades, quand on a la chance de trouver des feuilles de belle taille ; en soupe également, en purée. Les boutons floraux sont délicieux cuisinés à la façon des « brocolis » ou en « asperges ». Le goût très iodé de la plante, à forte odeur de poisson, est très étonnant !
 |
| Boulettes de calmar à la consoude |
 |
| Boulette détail |
 |
| Pavé de saumon sur lit de purée de consoude |
Purée de consoude
Faire revenir, après les avoir haché grossièrement, 1 gros oignon, 2 échalotes, 3 gousses d'ail et 1 petite carotte dans de l'huile d'olive, au bout de 5mn, ajouter les feuilles de consoude hachée gros, cuire 10mn, ajouter un jus de citron jaune, saler et poivrer, mixer grosseur selon votre préférence, et servir avec un poisson (ici, un pavé de saumon).
 |
Feuilles de consoude farcies (oignons, champignons,
porc haché, ail, sel et poivre)
Pour une entrée sympa ! |
Comme on le voit sur les deux photos ci-dessus, les feuilles de la consoude, surtout à la base, peuvent être très lancéolées ou plutôt rondes...
C'est une plante qui pousse souvent en colonie, mais on la trouve aussi en sujets isolés.
Celle-là, j'ai eu du mal à la photographier, elle était plus grande que moi !
NB : il y a encore peu, on considérait que la consoude était toxique à cause de la faible dose d’alcaloïde hépatotoxique qu’elle contient. Or les recherches récentes ont prouvé que celle-ci n’avait aucune incidence sur l’organisme humain. Mais on conseille quand même de la consommer avec modération (comme pour tout, d’ailleurs !).
Encore quelques photos, pour une reconnaissance facile de la plante ?

A gauche : une belle colonie, avec comme bannière une fleur en bouton !
A droite : détail de la fleur épanouie.
Attention : c'est à ce stade de végétation qu'on peut confondre la consoude avec la digitale. Mais il suffit de toucher les feuilles de la consoude pour s'apercevoir qu'elle est très rude ! En agrandissant la photo, on voit bien qu'elle est poilue !
A gauche : belle feuille à farcir !
A droite : feuilles de berce spondyle et de consoude (à droite) en beignets. La recette a déjà été publiée dans ce blog.
Un détail du "roulage" des nems ou dolmades de consoude ! Il faut blanchir les feuilles quelques secondes à l'eau très chaude pour les ramollir, et, surtout, enlever la grosse nervure centrale au dos de la feuille, sans déchirer celle-ci !
ADDENDUM
J'ai souvent tendance à omettre (!) d'écrire les recettes, tant tout me semble aller de soi en cuisine !!! Je publie donc ici la recette des boulettes de calmar ainsi que celle de mes feuilles de consoude farcis façon nem ou dolmades, je les dédicace à Mado (qui a raison de me secouer, je suis très paresseuse pour écrire les recettes !) avec quelques photos en prime pour me faire pardonner.
Boulettes de calmar à la consoude :
Pour une 50aine de boulettes :
- 20 grandes feuilles de consoude débarrassées complètement de la nervure centrale et hachées gros
- 2 gros calmars à détailler en petits cubes 1x1cm
- 2 gros oignons jaunes et 1 rouge bien fermes, coupés en gros dès
- 3 échalotes hachés gros
- 3 gousses d’ail hachées gros
. Mélanger tous ces ingrédients, saler et poivrer selon goût
. Passez le tout à la moulinette, hachis assez fin
. Façonner les boulettes à l’aide de deux cuillères à soupe
. Les déposer au fur et à mesure dans l’huile brûlante
. Les frire d’un côté 3mn, puis les retourner pour dorer l’autre face
. Egoutter sur du papier absorbant.
Le meilleur accompagnent est du riz blanc et une sauce tomate maison (je publierai ma recette sur l'autre blog la semaine prochaine).
**********
Nems (ou dolmades) de consoude aux champignons
- 12 grandes feuilles de consoude pour servir d'enveloppe, dont on aura enlever araser la nervure centrale au dos de la feuille (attention de ne pas la déchirer ni la séparer en deux, il faut qu’elle reste entière) ; les blanchir 2 ou trois secondes dans de l’eau frémissante pour les ramollir,
- quelques feuilles de consoude hachées supplémentaires pour mélanger à la farce,
- pour la farce : 12 champignons de Paris, 1 gros oignon, 1 gousse d’ail, le tout haché assez fin,
- 1 œuf pour lier le hachis,
. Bien mélanger tous les ingrédients du hachis, faire revenir rapidement à la poêle, saler et poivrer, laisser tiédir ou mieux refroidir,
. Rouler les nems : étaler une feuille de consoude à plat, mettre la farce au milieu à 2cm du bas,
replier les côtés puis le bas et rouler le nem jusqu’au bout de la feuille (voir sur la dernière photo avant l'addendum),
. Placer les nems dans une poêle en les serrant bien ; arroser d’un peu d’huile d’olive et de bouillon de légumes, cuire doucement 10 mn.
Servir comme entrée ou en accompagnement d’un poisson ou d’une viande.
**********